Ce mois-ci, le Polémarque déroge à la règle et s’attarde sur un roman, L’An dernier à Jérusalem, et son auteur, Myriam Sâr alias Sarah Vajda. Roman d’amour pour Israël, l’Israël du sable et des soldats chanté par Serge Gainsbourg en 1967, roman d’anticipation géopolitique : seul l’avenir nous dira s’il convient de ranger L’An dernier à Jérusalem dans la catégorie “uchronie”. Un avenir dangereusement proche. Et toujours, la leçon de style que renferme chacun de ses livres, comme un camouflet adressé à notre époque.
L. Schang
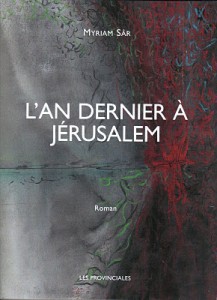 Toujours en construction, work in progress (nous la savons amatrice d’anglicismes), l’œuvre de Sarah Vajda se décline en deux trilogies, éparpillées au gré du vent (et des ventes) de l’éditeur le plus couru au plus confidentiel. Deux trilogies, deux cycles, l’un biographique (Barrès, Hallier, Gary), l’autre romanesque (Amnésie, Contamination, Le terminal des anges), écrits sans ordre déterminé mais avec la même ligne directrice, sous-tendue ou avouée, que nous résumerons à cette question : comment peut-on être juif et français ? Nous serions tentés d’ajouter après Auschwitz, en détournant quelque peu la pensée fleuve de Hans Jonas, mais ce faisant nous commettrions un contresens, pour ne pas dire un anachronisme. Ses aficionados – elle aime aussi les hispanismes – remarqueront que sa biographie de Claire Chazal, interdite par voie de justice, ne figure pas dans la liste. N’importe, si ce livre debordien en diable venait à reparaître, la trilogie deviendrait tétralogie. En tous les cas, si question il y a, c’est bien que le problème se pose. Demandez donc à Taguieff et à Finkielkraut. Sarah Vajda, freudo-barrésienne élevée à la mamelle de Barthes, robespierriste à Paris et sioniste tendance Jabotinsky à Tel-Aviv, a elle aussi son idée. À un moment donné, un maillon de la chaîne nationale s’est brisé et les familles spirituelles chères à Barrès ont cessé de communier ensemble. Cette cassure, car c’en est une, Sarah Vajda ne la date pas tant du retour des déportés « à l’Est » en 1945 que de la guerre livrée et gagnée en six jours contre ses voisins par certain État moyen-oriental « fier de lui et dominateur », le plus petit de la région après le Liban, en 1967. Annus horribilis, aurait placé un Flavius Josèphe dans la bouche de Titus.
Toujours en construction, work in progress (nous la savons amatrice d’anglicismes), l’œuvre de Sarah Vajda se décline en deux trilogies, éparpillées au gré du vent (et des ventes) de l’éditeur le plus couru au plus confidentiel. Deux trilogies, deux cycles, l’un biographique (Barrès, Hallier, Gary), l’autre romanesque (Amnésie, Contamination, Le terminal des anges), écrits sans ordre déterminé mais avec la même ligne directrice, sous-tendue ou avouée, que nous résumerons à cette question : comment peut-on être juif et français ? Nous serions tentés d’ajouter après Auschwitz, en détournant quelque peu la pensée fleuve de Hans Jonas, mais ce faisant nous commettrions un contresens, pour ne pas dire un anachronisme. Ses aficionados – elle aime aussi les hispanismes – remarqueront que sa biographie de Claire Chazal, interdite par voie de justice, ne figure pas dans la liste. N’importe, si ce livre debordien en diable venait à reparaître, la trilogie deviendrait tétralogie. En tous les cas, si question il y a, c’est bien que le problème se pose. Demandez donc à Taguieff et à Finkielkraut. Sarah Vajda, freudo-barrésienne élevée à la mamelle de Barthes, robespierriste à Paris et sioniste tendance Jabotinsky à Tel-Aviv, a elle aussi son idée. À un moment donné, un maillon de la chaîne nationale s’est brisé et les familles spirituelles chères à Barrès ont cessé de communier ensemble. Cette cassure, car c’en est une, Sarah Vajda ne la date pas tant du retour des déportés « à l’Est » en 1945 que de la guerre livrée et gagnée en six jours contre ses voisins par certain État moyen-oriental « fier de lui et dominateur », le plus petit de la région après le Liban, en 1967. Annus horribilis, aurait placé un Flavius Josèphe dans la bouche de Titus.
Israël rangé dans le camp des États oppresseurs pour avoir appliqué la loi vieille comme les guerres préhistoriques de l’attaque préventive, l’entité « Juifs » selon Drumont et Vallat va reprendre du service dans l’imaginaire conspirationniste, en panne de produit de substitution. Nous employons le mot d’entité, il est sûr que jugés ainsi les Juifs appartiennent davantage à l’univers de Lovecraft qu’au nôtre. Alors quoi ? Apatrides, les Juifs passent pour la lie de l’humanité et constitués en État-nation, on (les Nations Unies) les voue aux gémonies. Faudra-t-il toujours qu’ils s’exhibent en éternels moribonds décharnés pour qu’on les tolère dans la grande ronde des peuples ? En mai 68 les étudiants parisiens auront beau braver les CRS au cri de « Nous sommes tous des juifs allemands », le mal est fait, d’abord insidieux, qui va retrancher la communauté juive, réelle ou fantasmée, du corps national français au rythme de l’Histoire, accéléré par celui des mass media. Jusqu’à la jobardise de ces journées de 2010 où la capitale indifférente vit des jeunes filles voilées remonter tout sourire ses avenues, des pancartes « Israël = Hitler » brandies à bout de bras (qu’elles avaient couverts). Nous voyons d’ici le ban et l’arrière-ban des associations pro-palestiniennes, ou anti-israéliennes, cela revient au même, se lever comme un seul fedayin pour nous réciter la litanie des crimes contre l’humanité commis par Israël. Cuba oui, le Venezuela oui, l’Iran oui, Israël non ! Qu’ils se rassurent, si le dernier livre de Sarah Vajda dit vrai (alias Myriam Sâr, son alter ego israélienne, arrière-petite-fille d’un fameux escrimeur juif hongrois de l’entre-deux-guerres, le sosie de Paul Newman dans le film Exodus), au train où vont les événements, d’ici à quelques années l’État d’Israël aura cessé d’occuper leurs esprits et cessé d’occuper la Palestine tout court, le peuple élu reprendra la route de l’exode et nos modernes Silva retourneront au bon vieil antisémitisme d’antan, quand les choses étaient encore plus simples. Envolée la huppe fasciée, son territoire désormais interdit, la chasse à l’oiseau emblème d’Israël n’en sera que facilitée. On notera au passage l’évidente ressemblance du volatile et de l’écrivain : même plumage et même bec, même son strident sorti du même corps maigrelet.
Quant à nous, il nous plaît de considérer L’An dernier à Jérusalem comme l’ouverture d’un nouveau cycle dans l’œuvre de Sarah Vajda, le panneau central d’un vaste triptyque qu’il reste à nommer, dont les deux qui le précèdent seraient en fin de compte les volets initiaux.
Myriam Sâr, L’An dernier à Jérusalem, Les Provinciales, 2011, 156 p., 16 euros.




