 Et si la doctrine de guerre contre-insurrectionnelle (en anglais COIN, pour counterinsurgency), aujourd’hui en application en Afghanistan et en Irak, ne fonctionnait pas ? La question mérite d’être posée, alors qu’en Afghanistan la guerre entre dans sa dixième année et qu’au vu des événements actuels en Libye, une nouvelle intervention militaire sous mandat onusien n’est pas à exclure. Publié sous la direction de Georges-Henri Bricet des Vallons, chercheur et spécialiste des SMP qu’on retrouvera dans un prochain numéro de LVS mag, un ouvrage collectif, Faut-il brûler la contre-insurrection ?, apporte sa contribution au débat. Si le titre est explicite, les avis des participants sont plus nuancés, du « franchement pour, si… » du colonel français Le Nen (cf. LVS mag n°3) au « franchement contre » du colonel américain Gentile.
Et si la doctrine de guerre contre-insurrectionnelle (en anglais COIN, pour counterinsurgency), aujourd’hui en application en Afghanistan et en Irak, ne fonctionnait pas ? La question mérite d’être posée, alors qu’en Afghanistan la guerre entre dans sa dixième année et qu’au vu des événements actuels en Libye, une nouvelle intervention militaire sous mandat onusien n’est pas à exclure. Publié sous la direction de Georges-Henri Bricet des Vallons, chercheur et spécialiste des SMP qu’on retrouvera dans un prochain numéro de LVS mag, un ouvrage collectif, Faut-il brûler la contre-insurrection ?, apporte sa contribution au débat. Si le titre est explicite, les avis des participants sont plus nuancés, du « franchement pour, si… » du colonel français Le Nen (cf. LVS mag n°3) au « franchement contre » du colonel américain Gentile.
Directeur de recherches à l’IRSEM, professeur d’histoire militaire à l’École de guerre, auteur de livres remarqués, le colonel Goya est avant tout un homme de terrain écouté de la communauté militaire. Également collaborateur de ce livre, nous lui avons demandé ce qu’il pensait de la doctrine COIN.
On s’y perd un peu, à vrai dire, entre le manuel FM3.24 Counterinsurgency, le FT13, l’AJP-3.24, et maintenant l’AJP-3.4.4 qui devrait prochainement entrer en service. « Contre-insurrection », « guerre irrégulière », « guerre asymétrique », « guerre spéciale » : qu’est-ce que la doctrine COIN au juste ?
Cette abondance de définitions est le signe d’un trouble de la réflexion. Pour ma part, je propose de classer les opérations militaires de la manière suivante : il y a des situations où il n’y a pas d’ennemi désigné (opération de stabilisation) et des situations où des ennemis politiques tentent d’imposer leur volonté par la force des armes (opération de guerre) et dans chacune de ces situations, la population civile peut être l’actrice et l’enjeu ou simplement spectatrice et impliquée. On a donc des opérations de stabilisation au milieu des populations (Kosovo) ou d’interposition (Liban sud) et des guerres interétatiques ou entre États et organisations non étatiques comme pendant les « guerres » d’Indochine ou d’Algérie. Ces guerres contre des organisations non étatiques relèvent de la contre-insurrection. La difficulté est que dans certains théâtres d’opérations, comme en Afghanistan, on peut assister en fonction des zones et des désirs des acteurs à une juxtaposition de situations opérationnelles différentes.
 On ne parle jamais, y compris dans ce livre, d’un cas de guerre contre-insurrectionnelle réussie, que vous connaissez bien pour l’avoir traité, puisqu’il s’agit de la Colombie et de ce qu’on a appelé l’ « action intégrale ».
On ne parle jamais, y compris dans ce livre, d’un cas de guerre contre-insurrectionnelle réussie, que vous connaissez bien pour l’avoir traité, puisqu’il s’agit de la Colombie et de ce qu’on a appelé l’ « action intégrale ».
L’« action intégrale » colombienne est effectivement un exemple réussi de campagne de contre-insurrection. Sa réussite ne tient pas à la nouveauté de la doctrine. L’idée de combiner des « lignes d’opérations » politiques, sécuritaires, sociales et économiques pour pacifier progressivement des régions entières est communément admise en COIN. La différence est que l’État colombien n’agit pas en coalition pressée par le temps. Il a la volonté, le temps et peut réaliser l’unité d’action indispensable entre les différents acteurs civils et militaires. Ajoutons que la faiblesse relative des moyens financiers dont dispose cet État, par rapport aux coalitions dirigées par les États-Unis, est peut-être un atout dans la mesure où on n’assiste pas en Colombie à des injections massives et rapides d’argent très déstabilisatrices.
Sans même parler du livre de Marie-Dominique Robin sur les Escadrons de la mort, l’école française, est-il concevable de s’inspirer de méthodes liées au développement d’un empire colonial du 19ème siècle quand on veut instaurer la démocratie en Asie centrale en 2011 ?
Si analogie il doit y avoir, elle doit porter d’abord sur les projets politiques et ensuite seulement sur les méthodes employées pour atteindre ces objectifs. Dans les conflits de décolonisation, les organisations non étatiques comme le Viet-Minh en Indochine ou le Front de libération nationale en Algérie étaient les révolutionnaires et les Occidentaux étaient les conservateurs. Aujourd’hui, en Irak et en Afghanistan, les révolutionnaires sont les Américains. Ce sont eux qui veulent transformer complètement ces sociétés et la plupart de leurs adversaires sont des réactionnaires, au sens premier du terme. En ce sens, ces campagnes ressemblent plus aux conquêtes coloniales « civilisatrices » de la fin du 19e siècle, voire aux campagnes de la Révolution française, qu’à la lutte contre les organisations d’inspiration maoïste des années 1940-1950. En ce sens, il n’est effectivement pas inutile d’examiner les méthodes, efficaces, mises en œuvre par cette école de pensée « lyautéenne » dont on peut faire remonter les origines jusqu’à la pacification de l’Aragon par Suchet en 1812.
Lorsque Lyautey détaille son action au Maroc, il parle bien de « domination » à accepter de la part de tous les groupes amenés à circuler dans la zone, de gré ou de force. Cela ne relativise-t-il pas selon vous l’image toujours accolée à la COIN du marché rouvert, objectif prioritaire et premier indicateur de son succès ? Lyautey, lui, ne craint pas, dans un autre contexte, de parler de forces d’occupation.
Pour paraphraser Pascal, en COIN l’emploi de la force sans l’ « action civile » n’est souvent que brutalité et l’action civile sans la force aboutit à l’impuissance. En 2004 en Irak, la résistance simultanée de Falloujah et la révolte mahdiste dans le Sud chiite ont consacré respectivement l’inefficacité des méthodes brutales de certaines unités américaines et l’impuissance de la plupart des contingents européens. Quant à la conquête du Maroc, elle a été tout sauf non-violente. Plus de 1000 soldats français ou de l’Empire y sont tombés chaque année.
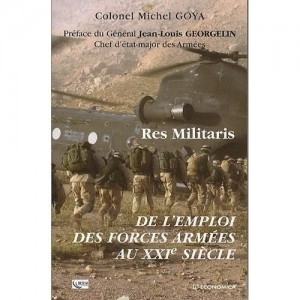 La doctrine COIN n’est-elle pas une illusion, dès lors que sa réussite dépend de l’installation d’un État et d’institutions à l’occidentale, où les droits de l’Homme sont l’alpha et l’oméga, soit une vision du monde à mille lieux des traditions et de la mentalité afghanes ? Quant à une armée et une police nationales afghanes, là aussi on est en droit de s’interroger.
La doctrine COIN n’est-elle pas une illusion, dès lors que sa réussite dépend de l’installation d’un État et d’institutions à l’occidentale, où les droits de l’Homme sont l’alpha et l’oméga, soit une vision du monde à mille lieux des traditions et de la mentalité afghanes ? Quant à une armée et une police nationales afghanes, là aussi on est en droit de s’interroger.
Il ne peut y avoir de sécurité que grâce à des forces de sécurité et celles-ci ne peuvent être efficaces que si elles sont reconnues comme légitimes et donc adossées à une administration et un système judiciaire eux-mêmes légitimes. Il y a un réel besoin d’administration en Afghanistan, le succès des Taliban tient d’ailleurs en grande partie à leur capacité à répondre, à leur manière, à ce besoin. Les difficultés de l’État afghan n’étaient pas inscrites dans ses gènes. Encore aurait-il peut-être fallu éviter de s’en remettre presque entièrement à des seigneurs de la guerre qui n’avaient aucun intérêt à l’édification d’un État fort ou imposer une constitution « à l’américaine » obligeant le président à négocier en permanence avec les hommes forts de l’Assemblée. Si on doit retenir un enseignement des campagnes coloniales d’un Gallieni ou d’un Lyautey, c’est bien celui de toucher le moins possible à la structure politique et sociale du pays dans lequel on intervient.
Vous l’avez dit vous-même ailleurs, si l’on ne circonscrit pas l’aide apportée par les plus hautes autorités pakistanaises aux insurgés, on ne pourra jamais gagner cette guerre, COIN ou pas.
L’erreur stratégique majeure de ce conflit a sans doute été de ne pas prendre en compte dès le départ les intérêts du Pakistan et de frapper leurs alliés Taliban en même temps qu’Al Qaïda, au lieu de dissocier les adversaires. A partir du moment, où les Taliban et Al Qaïda n’étaient pas détruits dès la fin de 2001 et avaient la possibilité de se réfugier dans les zones tribales pakistanaises, la possibilité d’une victoire s’éloignait d’un coup considérablement pour les États-Unis. Le Pakistan cherchera toujours à avoir un Afghanistan ami ou au moins neutre à ses frontières et tant qu’il n’aura pas cette assurance, il continuera probablement à aider les Taliban, et donc de fait, à empêcher leur destruction. Il paraît nécessaire pour les Américains, non plus d’essayer d’exercer des pressions sur le gouvernement et l’armée pakistanaise mais bien de négocier avec eux afin de pouvoir négocier ensuite avec les Taliban.
On penserait la COIN bien née pour soutenir la réforme des armées, or au contraire les moyens logistiques et technologiques déployés en Afghanistan sont un vrai gouffre financier pour la Défense. La doctrine COIN n’est-elle pas ruineuse pour le budget de l’armée française ?
L’adaptation à la COIN ne concerne véritablement que les armées de terre et donc marginalement les budgets d’investissement. Au bilan, depuis les achats en urgence opérationnelle jusqu’à la logistique sur place en passant par les phases d’entraînement en métropole, le coût annuel de l’intervention française en Afghanistan doit représenter environ l’équivalent de 2% du budget annuel de la défense. Peut-on considérer cela comme ruineux pour un enjeu de sécurité nationale ? Nous continuons à préférer très largement les programmes industriels issus de la guerre froide à l’adaptation à la COIN. Les forces armées de l’OTAN ont une maîtrise absolue du ciel et de la mer mais pas de la terre. Alors que plus de 90% des pertes en opérations concernent des combattants terrestres et que la destruction d’une seule section peut avoir des conséquences stratégiques nous nous refusons toujours à faire de nos petits échelons d’infanterie une priorité nationale.
 Omniprésentes sur le terrain, en Irak comme en Afghanistan, les sociétés militaires privées (SMP) ne constituent-elles pas un handicap supplémentaire pour la doctrine COIN ?
Omniprésentes sur le terrain, en Irak comme en Afghanistan, les sociétés militaires privées (SMP) ne constituent-elles pas un handicap supplémentaire pour la doctrine COIN ?
Il est évident que les SMP, avec leur pure logique économique et leur relative impunité légale, ne sont pas les meilleurs instruments de « conquête des cœurs et des esprits ». Rappelons que ce sont des membres d’une entreprise privée d’interrogatoires qui ont suscité les exactions de la prison d’Abou Ghraïb et que l’imprudence de membres de la société Blackwater a provoqué la première bataille de Falloujah. Les deux défaites majeures des Américains en Irak sont donc les conséquences de l’action de quelques contractors. Les SMP contribuent, avec les ONG, à la privatisation (et à la complexification) croissante des conflits et donc à réduire encore une unité d’action déjà réduite par l’action en coalition et en collaboration avec un État local. Or, comme cela a été évoqué pour le cas colombien, l’unité d’action est un élément indispensable de la réussite d’une campagne COIN.
Après dix ans de présence américaine en Afghanistan, la COIN ne risque-t-elle pas de devenir synonyme d’une guerre « qui n’en finit plus de finir » ? Le synonyme aussi d’une guerre où, faute de décision politique, il n’y a pas d’autre stratégie qu’on puisse appliquer. On se demande ce qu’il en restera après le retrait des forces de l’OTAN/ISAF, prévu à partir du 31 décembre 2011.
Il faut d’abord rappeler que ce type de conflit est généralement long et demande des moyens considérables. La campagne de pacification de l’Irlande du Nord, bien plus meurtrière que l’Afghanistan pour l’armée britannique, a duré officiellement trente-huit ans sur un territoire très réduit. La France a engagé plus de 450 000 hommes en Algérie, soit un soldat pour vingt habitants. La COIN demande des effectifs et pour l’instant on est loin de l’effort humain nécessaire en Afghanistan. Tout l’espoir réside dans la montée en puissance des forces de sécurité afghanes et le retrait des forces de l’OTAN ne doit normalement s’effectuer qu’en rapport avec cette montée en puissance.
Propos recueillis par L. Schang
Entretien précédemment paru dans La Voie Stratégique magazine n°4
À lire, sous la direction de Georges-Henri Bricet des Vallons, Faut-il brûler la contre-insurrection ?, avec les contributions de Georges-Henri Bricet des Vallons, Hervé de Courrèges, Gian P. Gentile, Emmanuel Germain, Michel Goya, Ahmed S. Hashim, Nicolas Le Nen, Michel Masson, Christian Olsson, David H. Ucko, Florent de Saint Victor, Stéphane Taillat, Elie Tenenbaum. 307 pages, Paris, Choiseul Éditions, 2010.




