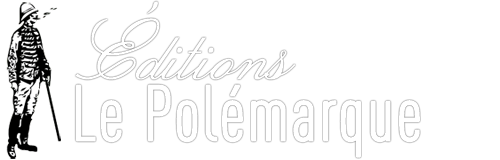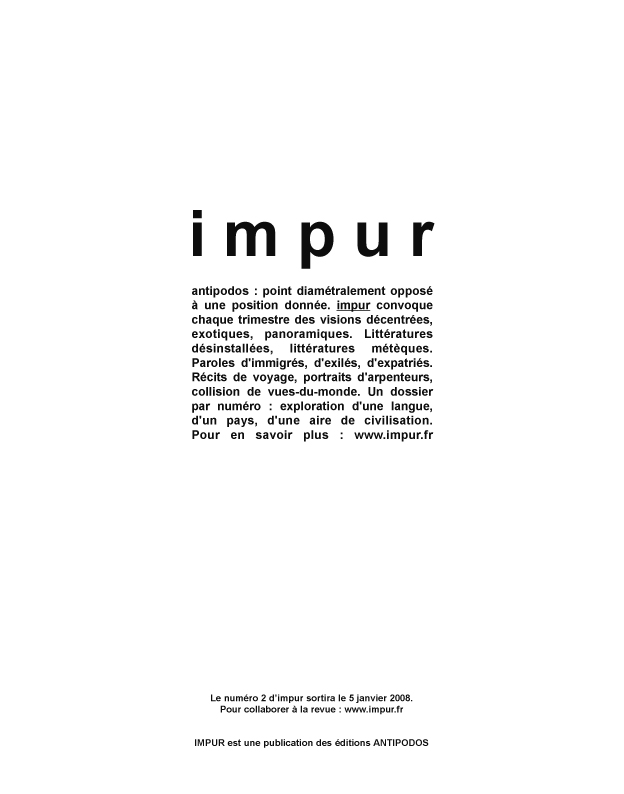 Au commencement était Cancer !, revue apériodique de qualité, fabriquée (c’est le mot) par des jeunes gens modernes, pour des jeunes gens modernes. De 2000 à 2004 dans sa garçonnière angevine, le sémillant Bruno Deniel-Laurent réussit le miracle de réunir sous la même couverture, entre deux soirées arrosées de sonorités martiales, des individualités bien peu faites pour se rencontrer ailleurs. La mèche tombante sur un nez aquilin, les mains rivées dans les poches d’un pantalon de flanelle retenu par des bretelles old school du meilleur aloi, BDL, la cheville ouvrière et l’âme incontestable du collectif, avait tout du rassembleur charismatique et rien du guide suprême. Quand donc un étudiant en lettres se penchera-t-il enfin sur cette « revue transgénique pluridisciplinaire » unique en son genre pour son sujet de master ?
Au commencement était Cancer !, revue apériodique de qualité, fabriquée (c’est le mot) par des jeunes gens modernes, pour des jeunes gens modernes. De 2000 à 2004 dans sa garçonnière angevine, le sémillant Bruno Deniel-Laurent réussit le miracle de réunir sous la même couverture, entre deux soirées arrosées de sonorités martiales, des individualités bien peu faites pour se rencontrer ailleurs. La mèche tombante sur un nez aquilin, les mains rivées dans les poches d’un pantalon de flanelle retenu par des bretelles old school du meilleur aloi, BDL, la cheville ouvrière et l’âme incontestable du collectif, avait tout du rassembleur charismatique et rien du guide suprême. Quand donc un étudiant en lettres se penchera-t-il enfin sur cette « revue transgénique pluridisciplinaire » unique en son genre pour son sujet de master ?
Deux livres* et un virage mystico-kabbalistique plus loin (l’épisode TsimTsoûm, laissé sans suite), Bruno, jamais en mal d’idées, me proposait de m’associer à son nouveau projet. Conçu comme un anti guide du routard, Impur Revue à problèmes parlerait de tout ce qui fâche sur notre belle planète. Bruno avait déjà trouvé un nom pour la structure associative : ce serait les Éditions antipodos. Aux dossiers Japon (#1) et Chine (#2) devaient succéder les dossiers Israël et l’Occident vu par les autres. L’axe Angers-Commercy était né.
La réalité fut quelque peu différente. Faute de ressources publicitaires, faute d’un réel diffuseur, le nôtre ayant déclaré forfait dès le n°1, faute de trouver des libraires assez curieux, faute de tout ce qu’on voudra, la revue fut mise en sommeil après la parution de son premier hors série, un recueil de textes de Jean-Jacques Langendorf devenus introuvables et rassemblés sous le titre Écrits afghans, coédité avec les Éditions Le Polémarque alors naissantes.
BDL vogue aujourd’hui vers d’autres horizons plus cinématographiques. Reste de ces treize mois d’existence précaire des textes originaux signés Sarah Vajda, Pierre Jourde, Taï-Luc, Laurent Maréchaux, Jean-Pierre Théolier… et Jean-Jacques Langendorf, dont on va lire ici le juste hommage rendu au colonel Olrik, l’ennemi juré et jusqu’à nouvel ordre malheureux de Blake et Mortimer, les deux falots compères britanniques, héros de la bande dessinée du même nom.
L. Schang
* Têtes de turc aux Éditions L’Âge d’Homme (2001), Gueules d’amour aux Éditions Mille et Une Nuits (2003).
 Éloge du colonel Olrik, homme de goût, de savoir et d’action, chef du 13e Bureau pour la sûreté de l’État, directeur des services d’espionnage de l’Empire, conseiller de l’empereur Basam Damdu
Éloge du colonel Olrik, homme de goût, de savoir et d’action, chef du 13e Bureau pour la sûreté de l’État, directeur des services d’espionnage de l’Empire, conseiller de l’empereur Basam DamduDès la deuxième image du premier album des aventures de Blake et Mortimer, il s’impose, souverain et élégant. Entouré par un état-major d’hommes jaunes et déférents, issus d’un croisement nippo-himalayen, il inspecte chars lance-flammes et fusées à charges nucléaires dans le grand arsenal de Lhassa. Arrêtons-nous d’abord sur sa capote vert foncé, au col de vison, aux épaulettes discrètes, d’une coupe parfaite, œuvre du premier tailleur de la capitale tibétaine. Examinons ensuite sa toque de fourrure, dont la face supérieure est doublée de satin rouge, marquée de l’étoile dorée. Mais il y a autre chose encore, qui suscite immédiatement sympathie et respect : son visage aux traits fins et aristocratiques, sa lèvre supérieure bordée d’une fine moustache à la Clarke Gable, sa chevelure jeais et son haut front d’intellectuel que nous pourrons admirer lorsque il condescendra à enlever son couvre-chef. Revêtu de son uniforme, nous ne nous lasserons jamais de le contempler. Le voilà debout, près des énormes roues d’un bombardier, des jumelles sur sa poitrine, des sangles supportant un ceinturon qui retient un étui à revolver ou, plus exactement, à Browning, à ses pieds un petit bijou de MG 42. Cette fois, c’est une casquette bordée de jaune qui remplace la toque de fourrure. Quant aux bandes, également jaunes, du pantalon de cheval gris souris, mais un gris souris tendre, très tendre, qui virerait presque au rose, elles sont l’apanage de l’officier d’état-major de la grande armée impériale. À n’en pas douter, nous avons là un colonel tsariste, style 1904-1905, observant la progression des tirailleurs japonais lors de la bataille de Taampin, avec toutefois l’anormale présence de soldats nippo-himalayens derrière lui. Mais aussi un aristocrate, la manière dont il tient son fume-cigarette l’attestant à satiété. Dans toutes les circonstances de la vie d’ailleurs, circonstances qui lui sont souvent contraires, il ne se départit pas de cette correction vestimentaire, qu’il erre dans le désert (culotte de cheval, bottes d’équitation, chemise de coupe coloniale), qu’il vaque à ses affaires dans les souks du Caire (costume blanc, chemise noire, cravate jaune tendre, feutre mou), qu’il enquête sur l’île atlantique de Sao Miguel (complet bleu foncé à fines rayures, chemise assortie, mais d’un bleu plus léger, nœud papillon), qu’il séjourne à Paris pour s’y occuper de questions météorologiques (à nouveau complet bleu mais sans rayures, chemise blanche, noeud papillon bordeau), qu’il inspecte les catacombes de la Ville Lumière (complet brun, chemise crème, cravate noire pointillée de jaune, feutre beige). Et que dire de sa robe de chambre rouge, à gros pois blancs, revêtue au débotté ? Mais je m’arrête là pour ne pas tomber dans la revue de mode…
Pour mieux saisir le niveau, on serait tenté de dire l’altitude, où se situe cette élégance, et derrière cette élégance, le personnage, il suffit de la comparer à la déliquescence vestimentaire des adversaires hargneux et acharnés du colonel, le professeur Mortimer et le capitaine Blake. Tous deux sont les rois de la confection, du prêt à porter et, certainement, des soldes. Voyez Mortimer qui, sur la quatrième de couverture, adresse un aguichant « hello » à ses lecteurs qu’il tient – fatale erreur – pour des admirateurs. Quelle tenue ! Celle du comptable d’une firme de sous-préfecture importatrice de pneus. La chemise s’affaisse sur une ceinture qui cerne un indécent bedon. La disharmonie entre un veston caca d’oie et un pantalon lie de vin, qui se prolonge par des souliers de souteneur napolitain, constitue une insulte à l’oeil. Et quelle est cette manière de faquin de s’adresser à son public, la pipe au bec ? À condition de revêtir l’uniforme, Blake s’en sort mieux, sauf s’il porte ces indécents shorts coloniaux, qui lui descendent jusqu’aux genoux. En tenue civile, cependant, il fleure le sous-officier qui, voulant échapper aux regards de ses supérieurs, se glisse subrepticement vers un lieu mal famé.
Au-delà du vestimentaire, c’est ensuite le courage, la tranquille intrépidité d’Olrik, qui retiennent notre attention. D’emblée, ils s’affirment sous nos yeux, lorsqu’avec l’élégant chasseur « l’aile rouge », il poursuit le « Golden Rocket », le laid bombardier dans lequel les Dioscures britanniques s’efforcent de lui échapper. Un vrai pilote, qui court sus à l’ennemi et qui ne craint jamais d’affronter les situations les plus périlleuses. Ainsi, lorsqu’il se fait passer pour un prisonnier anglais échappé afin de pouvoir s’introduire dans la base secrète des Britanniques, qui contrôle le Détroit d’Ormuz, dans laquelle il sabotera la station de pompage fournisseuse d’énergie, puis s’enfuyant, dissimulé sous une tenue de scaphandrier, alors que les services de sécurité de la base sont à ses trousses. Il n’a pas son égal pour se glisser là où on l’attend le moins, car son ingéniosité est sans limite et cette ingéniosité quelqu’un qui est revenu à plusieurs reprises de derrière les lignes soviétiques en possède une bonne dose. Pour répondre aux nécessités du moment, pour s’introduire là où il veut s’introduire, il se fera éminent archéologue allemand, spéléologue, chef d’une tribu barbare, agent à bord d’un sous-marin, égoutier, bourgeois cossu, locataire d’un élégant appartement parisien, et j’en passe.
Imaginons, en contre-point, ce qu’ont été l’enfance et l’adolescence d’Olrik, de vieille noblesse balte. Des heures solitaires sur une falaise de la Baltique, battu par les rafales, des lectures orientées par un oncle qui avait servi dans la Garde prussienne, et qui avait promis qu’il se vengerait un jour de la Révolution et des Spartakistes, du tir sur des bouteilles jetées à la mer, de la chasse, un duel à l’épée à douze ans, pour une broutille, avec un adversaire auquel il sectionna l’oreille. Plus tard, un séjour en Angleterre où il apprit entre autres à fabriquer de la fausse monnaie, un stage dans la Waffen SS qui l’initia au drill impitoyable, physique et intellectuel, de Bad Tölz puis un passage dans le commando « Brandenburg » (sabotages et enlèvements derrière les lignes soviétiques), enfin quelques mois dans la Légion étrangère, aussitôt après la guerre, avant qu’un envoyé du Grand Basam Damdu, qui passait par hasard à Sidi bel Abbès ne discerne ses mérites et ne l’engage au service de son maître. Puisque j’ai évoqué ses lectures, je vais donc aller jusqu’au bout car, mieux que tout autre chose, elles dessinent la silhouette morale d’un homme de sa trempe : Thucydide, Hobbes, Machiavel, Clausewitz, Rühle von Lilienstern, Lawrence d’Arabie, Colmar von der Goltz, le premier Jünger, Ludendorff, René Quinton pour ne citer que ceux qui en lui ont laissé des traces profondes. Examinons un peu les lectures de Mortimer, en laissant de côté les obligatoires ouvrages et revues scientifiques : les insipides romans de Sarah Summertown, un temps sa maîtresse, Memories of India de Baden-Powell, les idylles de Jane Austen, les poèmes de Pope. En ce qui concerne Blake, même en cherchant longuement, on ne découvrira pas grand’ chose : des règlements de service, Conan Doyle, le Livre de la Jungle (dont la leçon lui apparaîtra toutefois obscure), des guides de voyage, la Campagne de Mésopotamie de Townsend, surtout parce que son père avait été fait prisonnier à Kut al Amara avec lui, et des recueils de mots croisés. À petits esprits, petites lectures…
Pour ramener les choses au point essentiel disons qu’Olrik qui, tel un nouveau Sisyphe, remet sans cesse l’ouvrage sur le métier, ouvrage ensuite défait par les Dioscures, a atteint les sommets de la solitude tragique, qui est celle de l’aventurier car l’échec constitue la trame, la texture même, de son existence. Les rongeurs, les insectes, viendront un jour à bout du tigre royal, lui infligeront une blessure dont ils se repaîtront ensuite. Blake et Mortimer (petites idées, petit appartement, petites assurances, petites pantoufles, petits idéaux), appartiennent définitivement à cette catégorie. Dans une certaine mesure, alors que le type « Olrik » n’a cessé de se raréfier, les Dioscures scellent le triomphe du type humain qui a fini par dominer en Europe (et ailleurs) tel que, vers 1900, un Constantin Leontjev nous l’a annoncé dans un livre prophétique, L’Européen moyen, idéal et instrument de la destruction universelle : « Tous les auteurs nous présentent l’idéal de l’avenir comme quelque chose qui leur ressemble, c’est-à-dire le bourgeois européen. Quelque chose de moyen : ni un paysan, ni un seigneur, ni un guerrier, ni un prêtre, ni un Breton ou un Basque, ni un Tirolien ou un Tcherkesse, ni un marquis vêtu de velours et coiffé de plumes, ni un trappiste en robe de bure, ni un prélat en brocard… Non ! Ils se contentent tous de leur appartenance au minable type culturel moyen auquel ils sont redevables de leur position dans la société et de leur genre de vie, prétendant au nom du bonheur universel et de leur comportement diriger le monde du haut comme celui du bas.
Apparemment, ces gens ignorent et ne comprennent pas les lois de la beauté car précisément le type moyen est toujours et partout le plus inesthétique, le moins expressif, le moins intense et le moins noble, moins héroïque que des types humains plus complexes et plus extrêmes. »
Nous lisons aussi, à travers ces lignes, qui proclament le triomphe « moral » de Blake et Mortimer, le constat de décès de l’aventurier en général et d’Olrik en particulier.