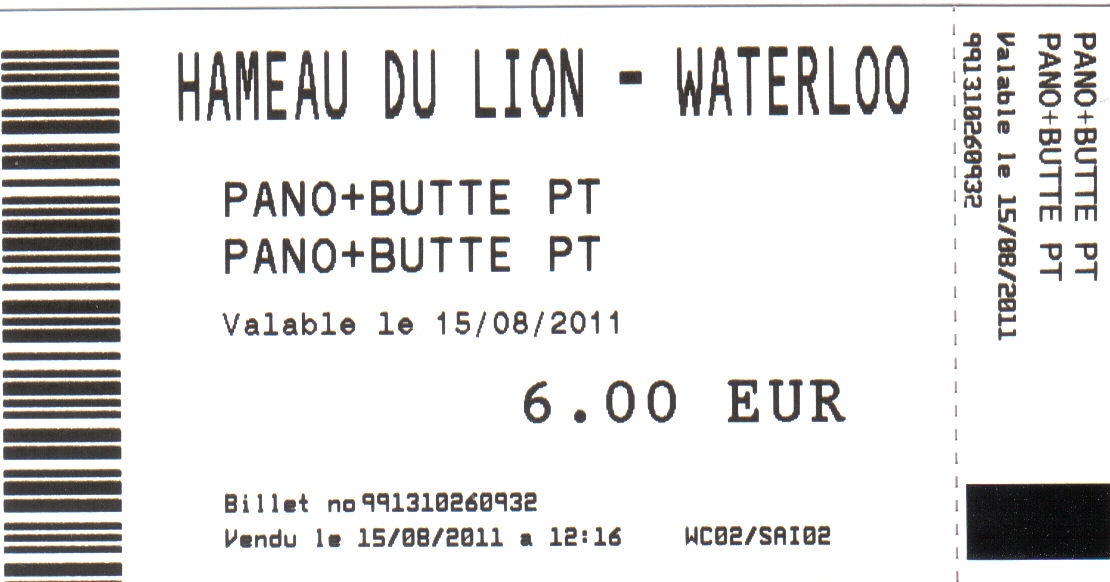 18 juin 1815, 18 juin 1940. Deux dates : Waterloo, l’appel de Londres, et deux noms : Napoléon Ier, Charles de Gaulle. Deux soldats, deux chefs, la fin de l’aventure pour l’un, son début pour l’autre, et la naissance de deux mythes de l’histoire de France : Napoléon, défait sur le terrain par la coalition anglo-prussienne à l’issue d’une bataille restée longtemps incertaine[1], vainqueur, chantera Hugo poète, des monarchies européennes sur le plan des idées ; de Gaulle, général rebelle, refusant la défaite incarnée par le maréchal Pétain, a pris l’avion la veille, premier Français Libre bientôt suivi de quelques milliers d’autres.
18 juin 1815, 18 juin 1940. Deux dates : Waterloo, l’appel de Londres, et deux noms : Napoléon Ier, Charles de Gaulle. Deux soldats, deux chefs, la fin de l’aventure pour l’un, son début pour l’autre, et la naissance de deux mythes de l’histoire de France : Napoléon, défait sur le terrain par la coalition anglo-prussienne à l’issue d’une bataille restée longtemps incertaine[1], vainqueur, chantera Hugo poète, des monarchies européennes sur le plan des idées ; de Gaulle, général rebelle, refusant la défaite incarnée par le maréchal Pétain, a pris l’avion la veille, premier Français Libre bientôt suivi de quelques milliers d’autres.
Depuis sa mort en 1821, on estime à un par jour le nombre de livres publiés à travers le monde ayant trait à l’Empire napoléonien. Et au sein de la droite française, gaullistes et bonapartistes continuent à se réclamer de leurs héritages respectifs, faits d’interventionnisme étatique et d’exhortations à l’indépendance nationale.
Napoléon Bonaparte écrivit beaucoup pour la postérité, des Bulletins de la Grande Armée, qui restent un modèle du genre deux siècles après leur publication dans le Moniteur, au Mémorial de Sainte-Hélène, où l’empereur déchu corrige la légende après l’avoir lui-même créée. Mais, on aura beau chercher, on ne trouvera nulle part dans ces milliers de pages un commentaire sur les grands hommes de guerre qui l’ont précédé. Tôt plongé dans l’action, Napoléon garda ses méditations pour ses campagnes. Au surplus, n’avait-il pas ramassé sa pensée dans cette sentence définitive : « Malheur au général qui vient sur le champ de bataille avec un système » ? Laissant à d’autres, comme Jomini, le soin de retracer la généalogie de son épopée.
Il n’en alla pas de même pour Charles de Gaulle, dont la production littéraire précéda en partie le passage du Rubicon. Avant la composition de ces Très Riches Heures du Connétable de Gaulle[2] que constituent les trois tomes de ses Mémoires de guerre, de Gaulle fut de ces officiers pensant qualifiés de « Jeunes Turcs » par l’historien François Cochet. La récente réédition chez Perrin de La France et son armée, travail de commande paru en 1938, qui vaut autant pour les péripéties qui entourèrent sa publication (narrées par le menu dans la préface) que pour son contenu, nous renseigne sur la place du premier empereur des Français dans le panthéon gaullien.
Qu’il est difficile a posteriori, quand la partie est jouée et bien jouée, de résister à la tentation de relire la vie d’un homme à l’aune de ses écrits antérieurs ! Par exemple, lorsqu’il écrit : « Ainsi, faute d’avoir à temps adapté son armée aux nécessités nouvelles, la France se trouve précipitée dans la pire crise de son histoire », de Gaulle, alors encore colonel, ne parle pas de la défaite de 1940 mais de la bataille perdue à Azincourt en… 1415. Le moyen de ne pas déceler dans ses propos une mise en garde au lecteur ? Son jugement sur Napoléon est éclairant, nettement moins inconditionnel qu’on ne s’y attendrait d’un officier de carrière de sa génération. Trop d’ambition, trop d’excès, génie dilapidé en pure perte, pour une vaine gloire, une France à l’arrivée exsangue, de Gaulle réserve son admiration à Louvois et Carnot, autant (déjà) politiques que soldats. Sa conclusion, la leçon qu’il en tire : la « merveilleuse vertu des armes » ne saurait toujours triompher du « juste courroux de la raison », justifie Waterloo comme elle annonce la substance du discours de Londres. Et ce verdict, rendu au regard de l’Histoire : « Nul n’a plus profondément agité les passions humaines, provoqué des haines plus ardentes, soulevé de plus furieuses malédictions ; quel nom, cependant, traîne en lui plus de dévouements et d’enthousiasmes, au point qu’on ne le prononce pas sans remuer dans les âmes comme une sourde ardeur ? »
Quel nom en effet, sinon peut-être le sien.
L. Schang




