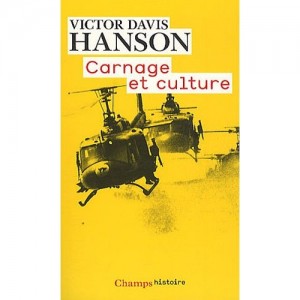 Hier de la responsabilité de tous avec le service national obligatoire, à présent affaire de techniciens professionnels, la chose militaire fascine toujours le public français – qu’il suffise pour s’en convaincre d’observer chaque année l’affluence au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées.
Hier de la responsabilité de tous avec le service national obligatoire, à présent affaire de techniciens professionnels, la chose militaire fascine toujours le public français – qu’il suffise pour s’en convaincre d’observer chaque année l’affluence au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées.
Forme historique de commerce entre les nations[1] en même temps que moyen universel de réguler la violence collective en la reportant sur autrui (le propre de l’homme des anthropologues), la guerre constitue en droit international, qui fonde sa légitimité et précise ses limites, l’acte suprême reconnu par lequel les sociétés antagonistes règlent leurs différends. « Toujours et partout, écrit le stratégiste Martin van Creveld, c’est dans ce seul cadre que l’acte de tuer, commis par une catégorie d’hommes habilités, dans certaines circonstances définies et en accord avec certaines lois édictées, n’est soumis à aucun blâme et devient digne d’éloges. » (in La transformation de la guerre, Monaco, Éd° du Rocher, 1998) Contraints par les événements, les peuples de l’Union européenne, de moins en moins belliqueux, deviennent de plus en plus militaristes. En changeant de siècle, les armées occidentales, confiées à des spécialistes, ont vu leurs missions modifiées en fonction de la nouvelle donne stratégique mondiale. On ne parle plus que de système global de défense, sécurités intérieure et extérieure confondues.
Aujourd’hui, après avoir mis la planète en coupe réglée au nom de la libre concurrence et de leur rationalisme à prétention universelle, les nations occidentales semblent tentées de se placer en retrait d’une histoire dont elles n’actionnent plus tous les leviers. Seuls les États-Unis, la plus jeune et la dernière puissance entrée en lice, échappent à ce raisonnement. En quoi le sourire des soldats de l’ISAF photographiés en 2010 diffère-t-il cependant de celui arboré par les Dix Mille, ces hoplites grecs lancés à la conquête de la Perse cinq siècles avant Jésus-Christ ? Très inférieurs en nombre, eux aussi progressaient en territoire hostile. Des désavantages compensés dans les deux cas par la même supériorité tactique, mais surtout par une culture militaire commune, faite d’esprit d’initiative, de savoir-faire technique et de discipline librement acceptée. À partir de l’étude de neuf batailles décisives choisies pour leur exemplarité, de Salamine à l’offensive vietnamienne du Têt, l’historien Victor Davis Hanson passe à la loupe ce qui dans les valeurs constitutives de la civilisation européenne assura le succès de ses armes. « Et ce fait s’explique, en dernière instance, par une attitude culturelle envers le rationalisme, la liberté de recherche et la dissémination du savoir : une attitude de longue date ancrée en Occident et qui trouve ses racines dans l’Antiquité classique sans être propre à aucune période particulière de l’histoire européenne. » S’il arriva dans le passé que les Occidentaux fussent défaits, ce fut toujours par un ennemi ayant adopté les pratiques militaires occidentales.
Que ce soit Israël vainqueur des États arabes coalisés comme Alexandre à Gaugamèles ou la levée en masse des citoyens américains sur le modèle romain après Pearl Harbor, dès l’Antiquité, conclut l’auteur de Carnage et culture, les bases de la guerre à l’occidentale étaient jetées. Une thèse et sa démonstration des plus convaincantes, à comparer (nuancer ?) avec les travaux de John Keegan.
L. Schang
Article précédemment paru dans La Voie Stratégique magazine n°2
Carnage et culture de Victor Davis Hanson, Paris, Flammarion, collection « Champs », 2010, 598 pages
[1] Albert Einstein, Sigmund Freud, Pourquoi la guerre ? Paris, Rivages Poche/Petite Bibliothèque, 2005.




