Alors que son nouveau livre intitulé Une histoire des forces spéciales vient de paraître, le journaliste Jean-Dominique Merchet (Guerres & Histoire, Marianne, Secret défense) a accepté de répondre à nos questions.
Aujourd’hui l’élite surarmée, surentraînée des grandes armées de ce monde, à l’origine une poignée de marginaux et d’excentriques équipés de bric et de broc – peut-être leur âge d’or paradoxalement, les forces spéciales suscitent autant l’admiration des magazines spécialisés que les interrogations de l’opinion publique. Comme on le lira dans l’entretien qui suit, il y a loin de l’image véhiculée par le cinéma hollywoodien (« le bras armé du pouvoir »), à la réalité et ce n’est pas le moindre des mérites du livre de Jean-Dominique Merchet, Une histoire des forces spéciales, d’avoir réussi à démêler le vrai du faux, sans jamais se départir de son style très Libé.
propos recueillis par L.Schang
 LP : Avant de parler des forces spéciales, j’aimerais savoir quel a été l’accueil réservé à Mourir pour l’Afghanistan, celui des militaires en particulier. Je rappelle le sous-titre du livre, paru en 2008 : Pourquoi nos soldats tombent-ils là-bas ?
LP : Avant de parler des forces spéciales, j’aimerais savoir quel a été l’accueil réservé à Mourir pour l’Afghanistan, celui des militaires en particulier. Je rappelle le sous-titre du livre, paru en 2008 : Pourquoi nos soldats tombent-ils là-bas ?
Jean-Dominique Merchet : Dans l’ensemble la réception du public a été bonne. Beaucoup des gens qui l’ont lu m’ont dit avoir apprécié l’honnêteté de mon travail, même s’ils ne partageaient pas forcément ma conclusion sur l’urgence d’étudier une porte de sortie au conflit. J’ai commencé à écrire ce livre tout de suite après l’embuscade d’Uzbin, sans idée préconçue. J’étais d’abord plutôt favorable à l’intervention française (et occidentale), mais au fur et à mesure que j’avançais dans la rédaction ma position a évolué et je suis devenu plus critique. En tout cas, le livre s’est vendu à plusieurs milliers d’exemplaires, sans qu’on me signale la moindre erreur factuelle. Certains militaires ont même reconnu que j’avais posé les bonnes questions.
LP : Comme son titre l’indique, Une histoire des forces spéciales se veut un ouvrage de synthèse sur la question. Vous consacrez plusieurs chapitres du livre à montrer le caractère évolutif du concept. Quelle différence y a-t-il, selon vous, entre les forces spéciales et ce qu’on appelle plus généralement les commandos ?
J-D M : Il n’y en a pas. C’est ce que je dis dans la première phrase du livre : « Nul ne sait ce que sont les forces spéciales. » Je continue à le penser. En France, il n’y a de forces spéciales reconnues que les unités du Commandement des Opérations Spéciales (1) en charge des actions militaires discrètes. Ce qui distingue les forces spéciales, 1er RPIMA (2), 13e RDP, CPA 10, commandos marine, des sections d’élite des régiments parachutistes, chasseurs alpins, etc., qui eux ne sont pas rattachés au COS, et ce qui exclut aussi la Division action de la DGSE. La meilleure définition est encore celle donnée par l’actuel commandant du COS, le général Beth : tout ce que font les forces spéciales, le gouvernement français doit à tout moment le revendiquer et l’assumer. C’est évidemment impossible en ce qui concerne les actions clandestines montées par la DGSE.
LP : Le recours trop fréquent aux forces spéciales, écrivez-vous, serait plutôt un indicateur de mauvaise santé pour les armées qui les emploient. Pouvez-vous préciser votre pensée ? En 2010, à combien se chiffre le nombre de soldats des forces spéciales en France ?
J-D M : Actuellement en France, les effectifs des forces spéciales s’élèvent à 3000 hommes, en majorité des « terriens ». À comparer aux 100 000 soldats de l’Armée de terre et aux 30 000, toutes armes confondues, que la France est en capacité de projeter (plus 5000 pour les « petites affaires » et 10 000 permanents sur le territoire national). Pour indication, aux États-Unis les forces spéciales représentent 3 p. cent de l’effectif total de l’armée, soit 48 000 hommes. Voilà pour les chiffres. Sur le fond, l’acte de naissance des forces spéciales, il faut remonter à la création des SAS en 1940. Les SAS furent d’abord inventés par les Britanniques pour porter des coups à l’Allemagne nazie, après que le rembarquement de Dunkerque eut laissé leur armée complètement démunie. Notez que le développement du bombardement stratégique sur les villes allemandes date de la même époque. De nos jours, l’envoi des forces spéciales répond aux besoins d’armées soit trop peu nombreuses, soit pas assez adaptables aux missions plus complexes, à l’image de l’armée américaine. J’ajouterai qu’en France on arrive peut-être à la fin de cette période. C’était encore vrai vers 2007-2008, quand l’armée régulière avait pour mission essentielle le maintien, voire le rétablissement de la paix à l’étranger. Depuis, nous sommes entrés dans une époque plus dangereuse. On aurait pu se contenter d’augmenter le nombre des forces spéciales, mais le chef d’État-major des armées, le général Georgelin (3) a fait un choix différent : « durcir » toute l’armée pour éviter la césure entre, d’un côté, un petit groupe engagé dans les opérations difficiles et, de l’autre, le reste, occupé à garder les casernes et à assurer les opérations civilo-militaires. D’où son idée de remettre les paras, la légion ou les chasseurs-alpins là où, il y a peu, on aurait encore envoyé les forces spéciales. Dans le livre, je raconte comment en 1917 le général Pétain prit une décision analogue, en choisissant d’améliorer tous les régiments de ligne plutôt que de s’inspirer des Sturmtruppen, les troupes d’assaut allemandes. Rétrospectivement, l’histoire lui a donné raison. Georgelin est un officier d’infanterie lui aussi, une arme faite pour les coups durs.
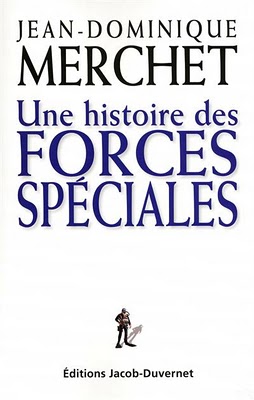 LP : Exemples à l’appui, vous démontrez les limites stratégiques du « tout forces spéciales ». Aujourd’hui très présentes en Afghanistan, les forces spéciales peuvent-elles à elles seules gagner une telle guerre ?
LP : Exemples à l’appui, vous démontrez les limites stratégiques du « tout forces spéciales ». Aujourd’hui très présentes en Afghanistan, les forces spéciales peuvent-elles à elles seules gagner une telle guerre ?
J-D M : C’est une vraie option stratégique. Aux États-Unis, le débat a eu lieu une première fois début 2000. Quand l’équipe Bush est arrivée au pouvoir, l’ambition de Donald Rumsfeld a été de réformer l’armée américaine, d’une lourdeur comparable à celle de l’ex Armée rouge, autour de deux idées : la haute technologie, le renseignement, les frappes à distance (soutenu il faut dire par ses amis industriels, qui voyaient déjà se profiler d’énormes contrats) et un engagement au sol très faible, à l’aide des seules forces spéciales. Mais très vite, le Secrétaire américain à la Défense s’est heurté à deux obstacles : le lobby militaire, hostile à tout dégraissage, et la réalité du terrain, car qui dit occupation de l’Irak, dit toujours plus de fantassins. Ce débat est revenu dans l’actualité stratégique en 2009, lors du long moment d’hésitation du président Obama sur la poursuite de la présence américaine en Afghanistan. Le commandant de l’ISAF, le général McChrystal, demandait plus de renforts, plus de monde sur le terrain, ce à quoi le vice-président Joe Biden répondait non, maintenant ça suffit, on se dégage et on intervient au coup par coup pour neutraliser l’ennemi, comme on le fait au Pakistan, au Yémen ou en Somalie. Il se trouve qu’aujourd’hui en Afghanistan, les deux stratégies coexistent. Laquelle des deux est la bonne ? Si vous me demandez mon avis, je plaide pour la thèse de Biden.
LP : Les forces spéciales françaises, vous le rappelez dans le livre, ont tout appris des SAS britanniques. Avec Trinquier et Galula par contre, les Français peuvent s’honorer d’avoir été des précurseurs en matière de contre-insurrection. L’intérêt porté par le général et stratège américain Petraeus (USCC) à leurs écrits est connu. Vous semblez plus sceptique. (NDLR : Cf. aussi l’article de J-D Merchet publié dans le n°10 de Guerres & Histoire : « Un outil de pauvre »)
J-D M : En effet, que les commandos marine portent le béret à gauche comme leurs homologues britanniques n’est pas anecdotique. En matière de contre-insurrection, si les Français ne sont pas mauvais, les Britanniques ne le sont pas non plus. Les Malayan Scouts ont vaincu l’insurrection en Malaisie, on ne peut pas en dire autant de notre armée en Indochine et en Algérie. Je ne suis pas un admirateur sans nuance de ce modèle français de contre-insurrection. Les méthodes d’il y a cinquante ans, apparues dans des contextes bien particuliers, ne sont pas forcément adaptées à l’Afghanistan. Il n’y a pas de recette miracle, de principe générique. Les deux situations sont trop différentes.
LP : Présentes en nombre en Irak, on constate aussi que les sociétés militaires privées le sont de plus en plus en Afghanistan. Peut-on envisager que des missions d’ordinaire dévolues aux forces spéciales leur soient un jour confiées ?
J-D M : J’espère bien que non. Ce sont des mercenaires, appelons les choses par leur nom. Je me méfie beaucoup de la privatisation de la violence légale et voir ainsi ressurgir les grandes compagnies de mercenariat ne me paraît pas le signe d’une évolution positive de notre monde. Du reste, il manquera toujours aux sociétés militaires privées quelque chose d’essentiel, ce service du pays qui justifie l’engagement et qu’aucun chèque à la fin du mois ne saurait remplacer.
 LP : L’entretien avec le général Poncet, patron du COS de 2001 à 2004, constitue un des moments forts du livre. Dans cet entretien, le « bel avenir » des forces spéciales paraît assuré. Or à vous lire, il suffirait d’un revirement de situation pour que les armées régulières repassent au premier plan. Qu’est-ce à dire ?
LP : L’entretien avec le général Poncet, patron du COS de 2001 à 2004, constitue un des moments forts du livre. Dans cet entretien, le « bel avenir » des forces spéciales paraît assuré. Or à vous lire, il suffirait d’un revirement de situation pour que les armées régulières repassent au premier plan. Qu’est-ce à dire ?
J-D M : Je vous répondrai par une boutade empruntée à Pierre Dac : « La prévision est difficile, surtout lorsqu’elle concerne l’avenir. » Nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise. Laquelle ? On n’en sait rien. Le général Georgelin a réussi à intégrer le concept de surprise stratégique dans le Livre blanc, c’est déjà une bonne chose. J’ai tendance à penser pour ma part que nous sortons de l’époque des guerres faciles, en gros celles des années 1990 (la première guerre d’Irak) à aujourd’hui. La guerre d’Afghanistan pourrait bien être le chant du cygne de cette période. Quarante hommes perdus en Afghanistan en huit ans, dont plus de la moitié en deux ans : une guerre facile comparée à la guerre d’Algérie, le vrai dernier épisode de guerre français, et ses dix morts par jour. La guerre de 14-18 : 900 morts par jour. L’histoire de France est jalonnée de périodes plus ou moins longues, la dernière en date remontant aux années 1815-1870, durant lesquelles les guerres ont toutes eu lieu en dehors du territoire national. Des guerres complètement sorties de la mémoire collective, dont le souvenir ne subsiste qu’à travers des stations de métro : Solferino, Magenta… Nous sommes du point de vue militaire dans une période qui y ressemble, sans réelle menace pour le territoire national. Espérons que ça durera, mais rien n’est moins sûr. Bien entendu, on aura toujours besoin de troupes d’élite un peu meilleures que les autres, mieux entraînées pour les opérations difficiles. Aujourd’hui, parce que les enjeux ne sont pas considérables, nous menons des guerres de moyenne ou faible intensité, où les forces spéciales, plus spectaculaires, sont au centre des regards. Mais que la situation change et l’attention se portera immédiatement sur notre capacité de riposte à des tirs de missiles et nos forces aériennes stratégiques.
LP : Et à moyen terme, des opérations spéciales dirigées par le secrétaire général de la PESD, vous y croyez ? Je vous pose la question en référence au titre du livre que vous avez publié en 2009 : Défense européenne, la Grande Illusion.
J-D M : Je n’y crois pas un instant. Le titre du livre résume ma pensée. Dans ces opérations, tant que tout se passe bien ça va ; sauf qu’à un moment il faut décider si oui ou non on ouvre le feu. On prend alors le risque de tuer un pirate et peut-être trois pêcheurs qui passaient par là, ou d’abattre un avion détourné avec 250 passagers à bord. Ce genre de décision ne se partage pas. C’est une question de légitimité, donc de souveraineté nationale. Le reste, c’est bon pour les colloques.
(1) Créé en 1992, le COS est un commandement interarmées (Terre, Air, Mer) placé sous les ordres directs du chef d’État-major des Armées (CEMA)
(2) Cf. le numéro du mois de mars de DSI, qui consacre sa une au 1er RPIMA
(3) Le général Georgelin a été remplacé en février par l’amiral Guillaud au poste de chef d’État-major des Armées




